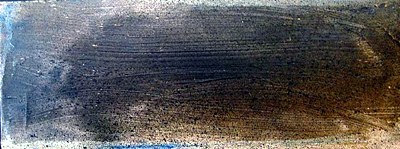Mais ce matin en moi les rayons d’automne sont comme au pire de l’été et me contredisent.
J’ai besoin de cette solitude près de toi si près de toi, à te toucher, les veines de tes doigts le long de ton bras, le hale de ton visage le poli si lisse la pudeur de tes seins signant ton corps de ballerine, chutant ton parfum colonise les objets la vie qui flotte l’air se déposant comme les pétales de rosée.
Comment puis je être loin et pourtant ma solitude si près, et nécessaire
afin d’échapper à ton emprise et mieux pouvoir me saisir, de nos rêves, des pensées qui comme deux corps tournent et s’attouchent se rejoignent un combat dans une frénésie se saisissent, face à face, la face contre la face, s’opposant dans un engagement et pourtant se nourrissant des choc frontaux et alliances, alliage des glaives, les dieux visibles dans la rage et voyelle une douceur sur les feuilles, le brillant du matin à la tombée du soir exigent le bouclier et sculptant l’age la stridence des troncs, effort d’un tellurisme naturel passant dans les bois qui ravinent les vies, ces accents du sol, terrailles alimentées des laves, que nous buvons
à la grande source,
au jaillissement de la couleur
et l’accord, à l’accord-danse
l’harmonie, crépuscule matinal de la déflagration solaire, rejaillit dans le prisme
à ton port la méditerranée, de figue la cote lisse abrupte du lin noir qui t’habille, je parle de ton nez, de tes joues et de ta jambe comme fille de la soie, ta chevelure comme la nuit triomphante du jour et le jour comme le tronc, le tiroir volcanique se penchant à tes lèvres, rouge de ta pensée incessante, suspendue à tes mains qui façonnent ou imaginent et rythment le temps, le temps rythmé te donne naissance dans la succession des signes du corps de la torsion, l’apaisement et l’entente décomptant les secondes qui t’éloignent et rapprochent le vif , peut être de la brume ou de la lune
et je suis le témoin de cette éclosion, joie sœur de l’angoisse, urgence cette force qui rompt les amarres et soudainement le gros temps, ce visage un marbre d’ébène, est ce le soir, ou le sud profond des vents, les bords aigus de la pensée qui piétine aux bords de l’attention, ce visage égyptien ou sable des déserts de la sauvagerie, je le vois nègre dans cette grande étendue de l’œil, sous les cils le mince traite de fusain et je le le voudrais tracer à pleine main s’il n’y avais la distance cette présence concentrée des dieux et grave, les lueurs circonflexes et l’horizon de toutes les mers à l’angle des forêts, l’aplat déconstruit en strates à l’aube de mourir plus affuté par le rabot qui défraie les jointures et dans ce crépuscule d’opale la tragédie sans minotaure d’avant le règne du chêne et que passe le chevreuil, quand l’ombre retient le sanglier et que filent les renards quand surgit la décision ou que l’espace se rompant délivre l’héritage.
Dans le geste quand nous regagnons la traine sur les graviers comme la filature de la hâte rejoignant dans la pente qu’est notre temps gagnant sur la nuit et qu’en moi pesant dégringole l’ancre qui s’en va se fixer dans les fonds, atteignant le noir et que je te regarde. perçant la lumière recouverte.
Si en moi pèse dans la nuit ce qui remue les feuillages, cette splendeur dont la tristesse me pleure et que je m’endors .