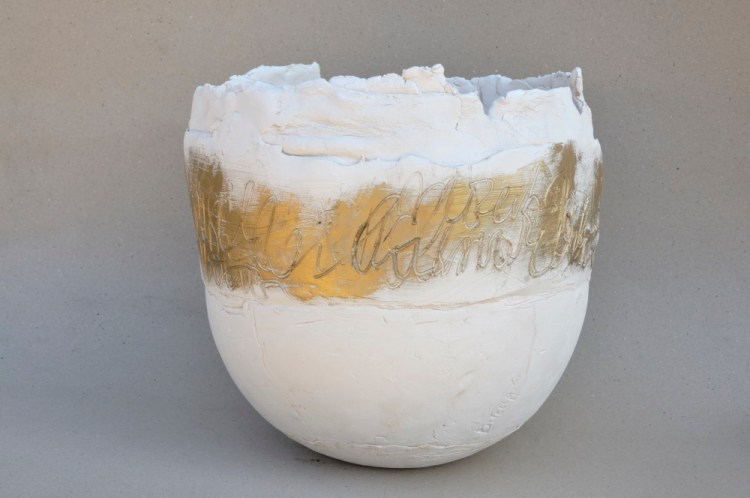Ramassé
comme un serpent dans un panier
le nœud
se confond avec les fruits
et les herbes posées un tapis
assis est comme debout
même si la nuit dehors
Comme dans la rue
l’étendue
et même dans la boue
ne la percevant pas
les arbres de la forêt
et les sourcils froncés
suffisent à la marche
deux mots bien taillés
même le brin le plus fin
quand il est coupé
Le nasal au plus près
de l’odeur et de l’ocre
on se rend compte
qu’au dessus de la tête
Il n’y a pas d’oiseaux
Ni outardes
Ni éperviers
allègre ou amère
l’année se suffit à elle même
et tu te redresses
de tes points de suture
la plaie
cousue d’un fil
le front puissant des rides
saisit au vol
libre de ce qui échappe
les feuilles dont ne fait rien
si elles ne sont pas la branche
le fruit que l’on mange
les nuages voyagent le ciel
plus qu’ils ne le découpent
un souffle c’est le vent
au dessus fonce de la force
et se tapie au fond du panier
à force réussit à élimer le corps
dont il ne reste plus que l’essentiel
à la survie
l’exercice
ce qui est déjà bien
quand on pense aux morts