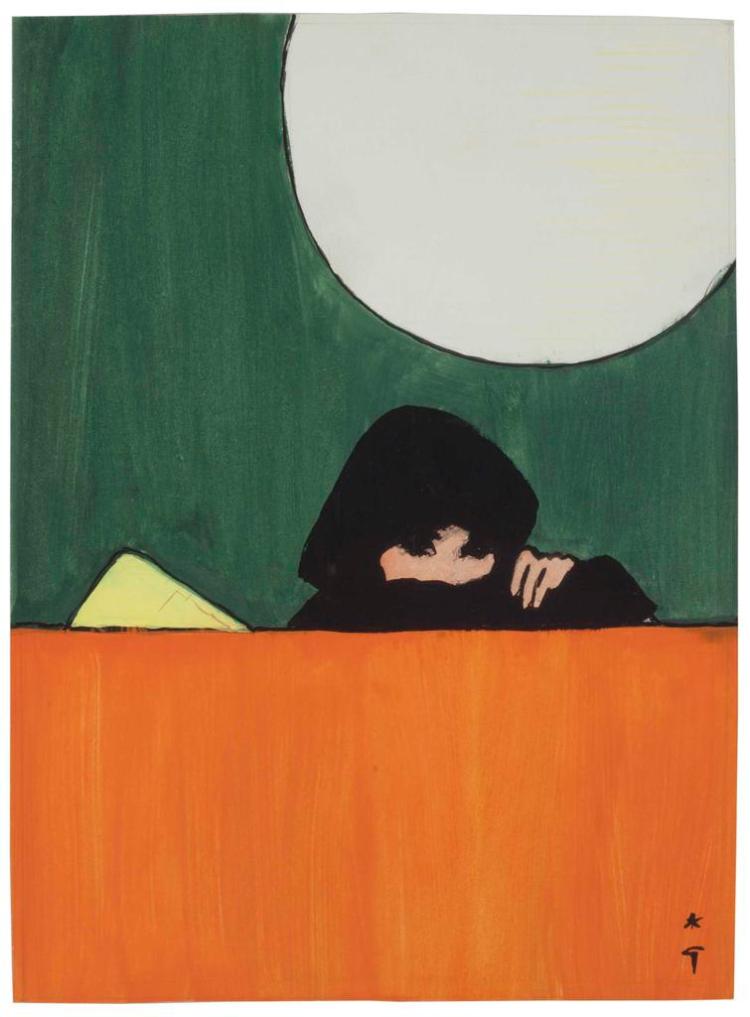Je repose le livre. Je suis noyé par des mots qui tournent en boucle. Sur eux mêmes, où la page où l’histoire. L’histoire qui est dans le livre et qui est trop loin, comme séparée de la vraie histoire, pas même encore mis en bouche et pendante, indécise, colérique et jouissive, au bout des mots de l’auteur qui vibre. L’autre, l’auteur qui est avant tout penseur et poète (Glissant) a beau ne pas être très clair, ils lâche les mots à bout de bras, les a lesté du passé et de l’avenir, les mots lâchés comme des fauves avec leur charge de dynamique, ouvrir le livre c’est s’exposer car ils sont prêt à mordre et ne sont pas bridés. Ce qui revient à dire qu’ils ont quitté leur condition de mots ils sont explosifs, chacun opposé . C’est un aspect des choses car les éléments du livre sont une accélération. Le livre possède sa propre vie et enflamme ce qu’il touche.
J’écoute la voix de Jolie Holland. Elle me dit la même chose, c’est peut être dans la voix, ou le chant, où l’accent systématiquement tordu ou c’est dans ce qu’elle ouvre, jamais certaine du présent et de ce qui se joue, il lui faut donc ouvrir, comme avec un ouvre-boite et à grand renfort d’énergie. J’ouvre une de mes voix préférée d’aujourd’hui, celle d’Ananda Devi (Pagli par exemple) sa voix, que l’on l’entends et que l’on sent comme une main, des doigts, un regard puissant, ouvre le livre comme une adresse, la voix te pose une question elle ouvre en toi un chemin, elle n’a rien d’impersonnel ni de stylistique, l’apparente poésie n’est que le contour du dessin que les mots empruntent pour aller jusqu’en toi. Sans aucune hésitation ni prétexte , elle n’en a pas besoin, elle ouvre, inlassablement elle parle comme un tire bouchon en toi.
Cette réflexion n’a rien d’abstrait , elle m’est venue après ou pendant que je rangeais la bibliothèque me demandant quels livres j’allais faire disparaitre. la plupart des livres racontaient une histoire terminée et fermée en boucle, une histoire bien cerclée sur le temps, un style prenant mais clos sur la narration, sans parallélisme et juxtaposition de deux ou plusieurs temps, caractères ,etc. Il fallait rentrer dans l’histoire pour y etre happé. L’histoire n’a t’elle d’autre existence qu’à l’intérieur d’elle même, pour elle-même et ne peut ‘on vivre à coté, en même temps ou malgré, comme quasiment en dehors. Les longs poèmes-chemins d’Israel Eliraz ont cette qualité et bien sûr les scénarios que nous propose David Simon dans the wire et treme , dont je n’ai pas fini d’explorer la magie, cette justement absence de finalité apparente qui est une qualité de ce qui ne peut finir. Comme refusant le confort intellectuel d’une chose se satisfaisant de soi et qui ne soit pas ouverte sur l’infini, ce qui bien sur est le cas, car tout, même formé, défini est malgré lui ouvert et sujet à l’infini, ce qui rend les choses difficiles si l’on veut ne pas s’éloigner de ce sentier, comme tomber sur le bas coté comme d’une falaise. Il faut être raisonnable, c’est celui de Tristram. Je veux dire qu’il faut être fou ou plutot constamment remettre la donne sur la table rien n’est jamais joué, tout continue sauf si l’on sort du jeu. On s’en sent bien mieux et la fausse prétention tombe.
Ne pas être affaire de style, ne pas se refermer sur soi ou le récit, l’éloignement c’est peut être aussi ce suspens que j’ai recherché dans l’art, ancien ou moderne du Japon, dans cet inaccompli, boucle qui rejailli sur un vide à conquérir, arpenter, clamer car il y a de la promenade et de la feuille qui refuse de se clore dans cette vision de la poésie et du texte ouvert sur le geste de l’en soi qui s’affirme pour ou sans s’emparer. Si la fascination pour l’improvisation, le jazz dont les valeurs sont la vie elle même comme en danse le geste qui suspend l’existence, lui intime de se manifester. Le propos tenu doit fatalement en finir avec lui même pour se survivre, et je pense à la très belle réflexion de L sur la nécessité d’accoucher de ce que l’on porte, le porter déjà, et le passer ensuite comme un présent et s’en sortir grandi, sans que cela soit contradictoire. On ne peut perpétuellement être gestation et ouvert sur l’inaccompli, de grandes joies s’ensuivent et il y faut une suite, ce rythme, celui des jours et des nuits. La page est constituée de points, de retours à la ligne mais quelque chose refuse de céder et revient continuellement sur le tapis, qu’est ce que c’est ?
Dans Treme, l’écrivain Creighton « Cray » Bernette enrage de ne pouvoir écrire avec la force de ses allocutions sur You tube, mais le livre est autre chose et l’écrivain est ancré sur l’idée que finalement la littérature demande cette maturation, que l’acte d’écrire revêt une importance que l’immédiateté n’a pas car il reste, qu’il y faut une distance (celle de presque un siècle et c’est l’inondation de 1927 qu’il veut décrire), peut t’il malgré lui être moderne et dans son temps en le couchant sur le papier. C’est avec raison et désespoir qu’il parle à ses étudiants de « the awakening » de Kate Chopin , où justement les péripéties et la succession d’épreuves n’ont d’autre finalité que de rapprocher de l’éveil. C’est ce se passe dans toutes les histoires que ces New-Orléanais vivent devant nous, la vie est chauffée à blanc et désespérée par la catastrophe, n’ayant rien à perdre, ils s’inventent, inventent, exige de la vie qu’elle se manifeste, comme dans le jazz et le vaudou, sans qu’il y ait d’issue ni de réponse que celle apportée à l’instant dans sa folie, dans sa bataille et sa détermination à remonter le courant.
Alors le livre doit il être clos comme témoignant d’un recul propice à l’observation et à la connaissance ou doit il être laissé dans le vif quitte à ne jamais guérir, l’accouchement doit il être perpétuel (bien sûr que non, yes , of Course L ) mais comme dans l’éveil, les phases d’accouchements successifs de l’être dans ou face au monde ne rapprochent ils pas d’une issue où ils seront comme entrenoués dans le passage. Le livre peut il se faire l’écho de ce trajet sans le fermer. Je pense à Dante, à l’Odyssée, à Ulysses de Joyce qui nient cette mise à distance et marchent au pas de ce recommencement. Comment s’emparer de ce perpétuum mobile, en refusant de céder face à l’écrit, qui est une autre tentative de muselage et de prise de distance. Par le truchement de la nuit, le jour ne s’ouvre que sur le jour, l’homme sur l’homme et toute prise de distance falsifie quelque chose de vif. J’aime Tristram Shandy pour cela. Et le livre quand on le reprend se met à aboyer. Reste ouvert sur soi-même perdu autour des autres sans nécessité de comprendre mais acharné à continuer.